
Annie Cazenave
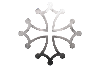

RENCONTRES DE MONTSEGUR
Les Cathares face à l’Histoire, des rebelles ou des résistants ?
© Annie Cazenave
Depuis le domaine paternel de Larminat l’enfant contemplait au loin la chaîne des Pyrénées dont se détachait, isolé, un piton. Adulte, Napoléon Peyrat a appris son nom : Montségur. Il l’a sauvé de l’oubli, et lui a redonné son histoire. Au bout de sept siècles, ce fut la renaissance d’une ruine, muée en symbole. Car dans l’imaginaire le passé vit, Jacqueline de Romilly* constate qu’une page de Thucydide**, pleine d’horreur et de scandale, nous touche encore…
Avec son Histoire des Albigeois Napoléon Peyrat a bousculé l’histoire officielle, occupée de la seule Croisade. Descendant de Camisards, il a assimilé à ses ancêtres les vaincus et leur longue résistance. La prise de Montségur en 1244 marque la fin de leur rébellion. Mais la seule fin de l’insoumission armée, non celle de la sédition religieuse. Peyrat, disciple de Jules Michelet, a mis plus de vingt ans à déchiffrer, en prenant parti pour les victimes, les registres où les inquisiteurs avaient consignés les interrogatoires de leurs prisonniers. A la parution du livre la mode du romantisme était passée. Si les historiens de métier ont rechigné devant sa prose enflammée, les félibres occitans du XIXéme s. ont lu Peyrat avec enthousiasme, il leur insufflait, comme Frédéric Mistral, la fierté et l’amour de leur terre.
Depuis, les auteurs de livres sur cette période se partagent en deux camps, dont le jugement peut se résumer ainsi : rebelles ou résistants ? L’historien les bannit ou les exalte. Il s’intéresse de préférence ou au politique, ou au religieux.
L es rebelles
Dans le camp de l’histoire politique, celui des tenants du récit national et de l’unité française, se range Pierre Belperron. Son travail sérieux s’appuie sur l’Histoire de Languedoc de dom Vic et dom Vaissette, mais, s’il faut dire à sa décharge qu’il avait auparavant étudié la Guerre de Sécession, il a eu l’idée discutable de se placer dans la perspective de son livre précédent pour prôner l’union du Nord et du Midi… dans un ouvrage paru en 1942. Charles Petit- Dutaillis en a fait une recension sévère. Citant l’introduction militante : « la Croisade a été avec l’Inquisition classée dans l’arsenal antitraditionnaliste, antireligieux, antinational, où s’approvisionnait le clan qui avait pris à tâche de tuer l’âme de la France », l’historien constate : « j’ose dire….que je ne sais s’il accepterait de définir l’âme française ». L’arrière plan n’avait pas échappé au romaniste Charles Camproux à Montpellier, lequel, résistant, était resté prudent.
Les résistants : le félibrige
Les historiens jettent sur l’époque étudiée un regard forcément rétrospectif. N. Peyrat s’en targue. Car ce pasteur protestant élabore une théologie de l’histoire : les Cathares prennent place dans une théorie de contestataires qui part de Vigilance, passe par Abélard et aboutit à la Réforme, mais n’est pas achevée, elle avance vers une société qui renversera « la théocratie » et sera démocratique et libre : ce sont « les spirales ascendantes des batailles du Paraclet », qui lui donnent foi en l’avenir : franc-maçon il magnifie Montségur comme un temple, à la fois tombeau et berceau. Après un désastre, qui le consterne, il a vu l’avènement de la République, et une génération nouvelle, celle des félibres rouges, républicains, le choisit comme aujol, aïeul : ces occitans, déférents envers Frédéric Mistral, se démarquent des provençaux rieurs, « assez de tambourins et de cigales ». Comme eux ils célèbrent la langue d’Oc, celle des troubadours, et instaurent une république des lettres, où seul compte le talent. Mais ils ont un projet politique. En 1876 Louis Xavier de Ricard, ancien communard réfugié à Montpellier, publie la revue La lauseta. Ils veulent « la Renaissance du Midi, c'est-à-dire sa Renaissance dialectale et littéraire, autant que la Renaissance politique » Sept d’entre eux fondent « l’escolo de Mountségur », qui a son siège social chez l’un d’eux, leur éditeur Jean Gadrat, à Foix, 22, rue Labistour. Ils assurent « s’être abreuvés à la source amère et fortifiante de l’histoire si mal connue et tellement falsifiée de la terre d‘oc ». Ils se veulent les artisans d’un Midi libre, c'est-à-dire girondin, dans une France fédérée dans « l’arc latin», qui, suivant la courbe de la Méditerranée, va de la Roumanie à la Catalogne. Ils chantent, debout, La coupo santo, et prennent le château de Montségur comme symbole du triste passé et du renouveau. En 1914 la guerre met fin à leur espoir et à leur groupe.

L’écriture de l’histoire
Autour de 1905 le différend sur la Séparation de l’Eglise et de l’Etat se profilait en arrière plan de la polémique entre deux médiévistes, le protestant Auguste Molinier et le dominicain Camille Douais. Car dans la personnalité de chacun des a priori, conscients ou inconscients, influent sur sa perception de l’histoire et, partant, du catharisme. Dans ce cas elle dépend de sa formation, théologien ou historien, de sa méthode, et aussi de son époque, et modèle, parfois à leur insu, leur écriture de l’histoire. C’est ainsi qu’Yves Dossat a cru et proclamé qu’à Montségur n’avait pas existé de bûcher. Le récit des épisodes de l’affaire, anciens et modernes, ne manque pas de piquant : l’évêque d’Albi, Bernard de Castanet, irrité par l’opposition du viguier, avait demandé à l’inquisiteur de rechercher si dans la famille du trublion ne se trouvait pas quelque incapacité (les descendants d’hérétiques ne pouvant pas exercer de charges publiques, il s’en serait ainsi débarrassé). Et en 1306 l’inquisiteur Geoffroy d’Ablis trouve, en effet : Adalaïs Raseire, grand-mère paternelle du viguier, a été prise à Montségur et brûlée à Bram. Il lui envoie sa découverte dans un vidimus, écrit qui reproduit et certifie l’acte original ( ce qui, par parenthèse, montre la parfaite tenue des livres de l’inquisition) . Y. Dossat tombe sur la copie de l’acte dans le T.XXXIV de la collection Doat, et s’exclame : si elle a été brûlée à Bram, c’est donc que le bûcher a été allumé à Bram. Oui, certes : le sien.
L’historien a extrapolé à partir d’un seul acte. De nombreuses autres pièces mentionnent le bûcher, dont dans le dossier KK aux Archives Nationales celles qui, vers 1256, examinent les demandes en restitution de biens confisqués aux hérétiques : pour les rejeter elles précisent que l’aïeul du demandeur a été pris à Montségur et fuit combustus ibi , et y fut brûlé : ibi signifie là, et non à quarante kilomètres. Quel obscur motif a poussé Dossat à cette myopie ? son hypercritique est d’autant plus étrange que c’est lui qui a retrouvé la date exacte du bûcher, et donc grâce à lui que la commémoration a été instaurée au 16 mars. Car il a eu le courage de rédiger sa thèse sur « Les crises de l’inquisition toulousaine, 1233-1273 »,Bordeaux, 1959, alors que l’université se détournait délibérément de ce sujet, manifestant un dédain peut-être inspiré par un respect de la laïcité le rendant suspect, peut-être par mépris jacobin de l’esprit provincial, peut-être agacée par les outrances de la littérature méridionale contemporaine. Ou par une combinaison des trois.
L’imaginaire autour du catharisme
La voie ouverte par Peyrat était en effet devenue autoroute, où s’élançaient allégrement nombre d’auteurs farcis de « connaissances acquises à l’ombre de la croix occitane » (sic).
Par exemple, Maurice Magre dans « Le sang de Toulouse » campe le fils d’un bâtisseur de cathédrales partant sus à la horde des envahisseurs français, dans des aventures qui le conduisent inéluctablement à Montségur. Maurice Magre, à cause de la réincarnation, s’était d’ailleurs converti au bouddhisme. Des amateurs modernes partent en quête du trésor des Albigeois, sorti de nuit du château par des évadés et caché, pense-t-on, dans les grottes du Sabartès. Ce qui procure d’agréables distractions aux curistes d’Ussat, et attire dans la station un curieux personnage, Otto Rahn, allemand féru d’ésotérisme et soupçonné de nazisme. Cette littérature pétrie de nostalgie s’est épanouie entre les deux guerres. De nos jours les Rose-Croix ont établi leur quartier général à Ussat.
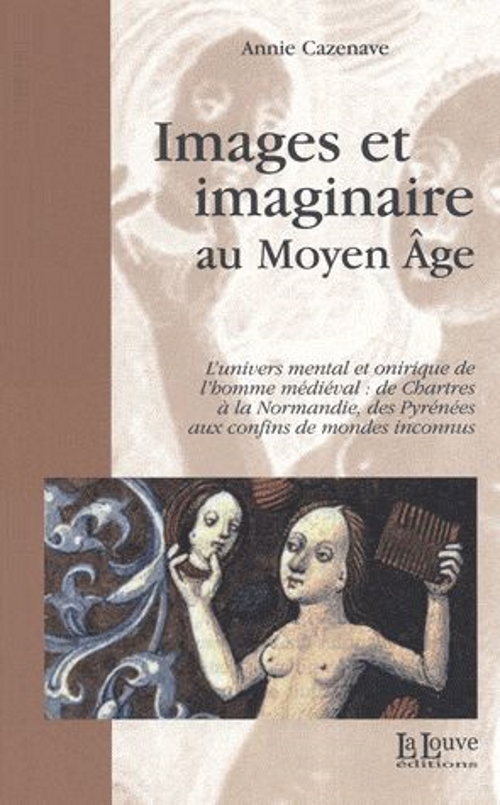
L a cité savante
Ces fantaisies littéraires et poétiques font aisément comprendre le raidissement des érudits.
Mais il ne concerne que les seuls historiens universitaires. A l’écart de la foule, dans ce que les sociologues appellent « la cité savante » des chercheurs travaillent en paix, au Collège de France, au C.N.R.S., à l’Ecole des Hautes Etudes, à l‘Institut de Recherche d’Histoire des Textes. A l’Université d’Uppsala Hans Söderberg, qui a bénéficié des travaux d’Henri-Charles Puech, a passé en 1959 sa thèse, rédigée en français, sur « La religion des cathares. Etude sur le gnosticisme de la basse antiquité et du Moyen-âge ».
A la chaire d’histoire des religions du Collège de France, en effet, Henri-Charles Puech étudiait le gnosticisme, le manichéisme et le néoplatonisme, dont il a repéré une trace dans l’enseignement de Peire Authié transmis par ses croyants. Jean Duvernoy s’en souviendra en intitulant un article « Origène et le berger ».
La philosophe Simone Pétrement lit elle aussi les gnostiques, ils lui inspirent son titre : Le dieu séparé(1985). René Nelli suit la même voie. Fernand Niel a peut-être tiré de ses lectures l’idée de voir en Montségur un temple manichéen.
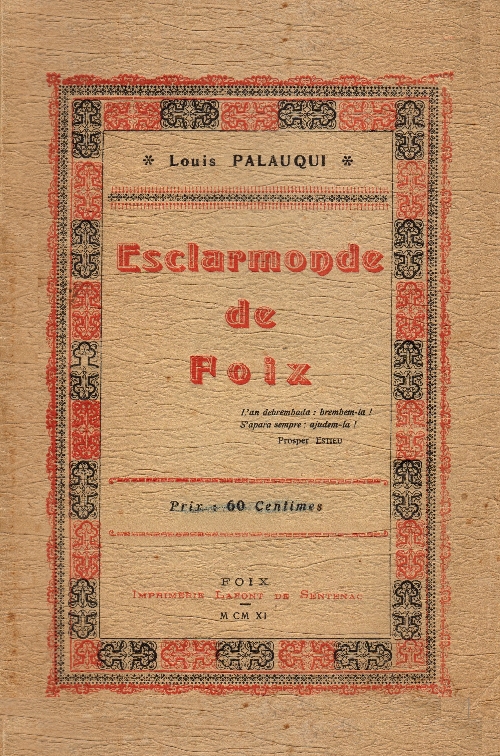
La marginalité
L’ostracisme des historiens universitaires a donc produit un effet inattendu : c’est en dehors d’eux qu’ont été menés les recherches. Mais peut-être est-ce le sujet lui-même qui impose sa marginalité, puisqu’elle s’est produite aussi en Allemagne : Ignaz von Döllinger, prêtre catholique professeur de théologie à l’université de Munich, excommunié en 1871 pour avoir refusé le dogme de l’infaillibilité pontificale, a pour se défendre publié Beitrage zur Kirchengeschichte, 1878, et dans les pièces justificatives du t.III des extraits des procès verbaux d’inquisition, dont celles de « nos » Cathares. En particulier il reproduit la déposition de Jean Maury contenant la prière : « Payre sant, Deù droiturier dels bons esperits… » que, jusqu’à l’édition de Duvernoy, les érudits ne connaissaient que par cette édition – connue des érudits seuls : importante précision, car dans le pays de Sault on continuait, depuis le XIVéme s., à la réciter pieusement dans les familles, en l’enseignant d’une génération à l’autre, de grand-mère à petit-fils, en patois, mais en en ayant perdu le sens, la croyant catholique et ignorant quel pouvait être ce Dieu juste des bons esprits. L’auteur de ces lignes l’a entendue de la bouche d’un Clergue, mais ce témoignage ne vaut aujourd’hui plus grand-chose, les gens de Montaillou ayant repris possession de leur mémoire. Toutefois il indique la pérennité de la tradition orale, et un rapport au temps correspondant à celui que Michel de Certeau étudie dans ses travaux sur la mystique.
A la découverte des manuscrits originaux
Ce rapprochement parait d’autant plus pertinent que le psychanalyste jésuite s’est précisément intéressé à la marginalité. Or, mis à part le professeur Raoul Manselli qui, comme italien, n’entre pas dans une catégorie qu’écarte le souci de la laïcité, tous les chercheurs sur ce sujet sont des isolés. Et non des moindres : le père Dondaine, O.P., a révolutionné la connaissance du catharisme : dans la Bibliothèque Nationale de Florence, section des couvents supprimés, il a découvert ce qui lui paraissait « éminemment souhaitable et fortement improbable » : un écrit cathare ayant échappé à la destruction : le « Livre des deux principes » : « pour la première fois la voix de l’hérétique se faisait entendre ». Et quelle voix ! D’un niveau de pensée nettement supérieur aux écrits catholiques contemporains. Ce qui laisse entrevoir quelle pouvait être la richesse spéculative des Bons chrétiens. Le père Dondaine l’a publié, avec d’autres articles aussi fondamentaux (1946-1952) dans la revue de son ordre, l’ Archivum fratrum praedicatorum.René Nelli l’a offert en traduction française dans ses Ecritures cathares. Malheureusement, le maître général des frères prêcheurs a affecté le père Dondaine à l’édition des œuvres de Thomas d’Aquin, et il s’est effacé dans une « généreuse obéissance », permettant ainsi la promotion de Ch. Thouzellier à une place qu’elle n’a pas totalement occupée.
Autre isolé, le juriste Jean Duvernoy s’est attelé au déchiffrage du ms Vatican 4030, le Registre d’inquisition de Jacques Fournier (1318-1325) publié à Toulouse par l’éditeur Privat avec le concours du C.N.R.S. (1965). L’évêque de Pamiers, transféré au siège de Mirepoix, devenu cardinal puis le pape Benoît XII, a scrupuleusement, minutieusement, épouillé son diocèse, interrogeant ses ouailles dans les moindres détails, non seulement de leurs opinions déviantes, mais aussi de leurs moeurs, leur faisant raconter leurs faits et gestes, laissant ainsi un document rigoureusement unique. Emmanuel Le Roy Ladurie en a tiré son Montaillou village occitan (1975) qui, contredisant la vision étriquée d’un obscur Moyen-Age en montrant des montagnards rebelles,a été un succès de librairie.
Le public lettré
Michel Roquebert enfin, après le bel Citadelles du vertige, a consacré sa vie à l’Epopée cathare (1970-1998), Grand Prix Gobert de l’Académie française. Et son œuvre n’est pas achevée, puisque vient de paraître son nouveau livre sur les Figures du catharisme. En dix-sept chapitres il joue sur la plasticité du mot pour à la fois retracer les mythes cathares et s’immerger dans le quotidien des acteurs du drame, du clan nobiliaire à l’humble bouvier,.
A Carcassonne entre les deux guerres Joë Bousquet, tétraplégique après une grave blessure reçue au front, a réuni autour de son lit l’élite littéraire et artistique contemporaine, dont René Cassou, Jean Mistler devenu plus tard académicien, et ,avec Max Ernst, la branche méditerranéenne des surréalistes. La revue Les Cahiers du Sud (1914-1966) les édite, dont en 1942 le numéro resté célèbre : « Le génie d’Oc et l’homme méditerranéen ». Le jeune René Nelli a fait son miel de ces fréquentations, il a élaboré une personnalité originale, à la fois poétique et littéraire, en oc et en français, dans des domaines variés, historique, folklorique, et enfin philosophique : après un mémoire de D.E.S. sur Plotin, une thèse sur La philosophie du catharisme. Le dualisme radical au XIIIéme s.(1975) qu’encadrent des ouvrages sur les troubadours, le roman de Flamenca,ou « Du jeu subtil à l’amour fou », de Raimon de Miraval, auquel il s’identifiait. Chaleureux, convivial, René Nelli a voulu réunir tous les amoureux de l’Occitanie et fervents du catharisme, et fondé en 1981 le Centre d’Etudes cathares qui a duré trente ans et dont la première directrice, la chartiste Anne Brenon, a publié la Revue Heresis , incomparable recueil d’articles de tout premier ordre. La disparition de ce centre laisse un vide insondable.
Car ce temps est celui des convergences, où les solitaires sortent de leur isolement pour se rencontrer et palabrer ; avec le père dominicain Marie- Humbert Vicaire, le chanoine Etienne Delaruelle, agrégé d’histoire, fonde les Cahiers de Fanjeaux, dont les colloques réunissent des chercheurs de tous pays, dans un esprit de discussion libre et ouverte, qui n’empêche pas de franches oppositions. Celles-ci ont concerné en particulier l’histoire sociale de l’hérésie. Raffaello Morghen l’avait déjà exposée en 1968 au colloque dirigé par Jacques Le Goff à Royaumont sur Hérésie et société dans l’Europe pré-industrielle. Teintées de marxisme, elles apparaissent à la même date en controverse dans le n°3 des Cahiers de Fanjeaux. Dondaine, absent, domine le débat. Au contraire Raoul Manselli, comme dans son livre l’Eresia del male, valorise la spiritualité cathare. Le n° 20 des Cahiers pose la question : Effacement du catharisme ?
1968 et le renouveau occitan
Mai 68 apporte un sang nouveau, une vigueur nouvelle, Yves Rouquette les magnifie dans un lyrisme flamboyant. Montségur incarne les revendications occitanes chantées par Claude Marti : « Indiens de toutes les couleurs nous décoloniserons la terre, Montségur tu te dresses partout » La commémoration officielle en 2009 du sac de Béziers parait bien fade après cette exaltante utopie.
En 1998 le 7éme colloque du Centre d’Etudes cathares/ René Nelli dresse en 478 pages avec « Catharisme, l’édifice imaginaire » un monumental inventaire qui rétrospectivement parait avec nostalgie figurer un état des lieux. Le sommaire récapitule :
La réécriture de l’histoire
La récupération ésotérique.
Le souvenir des martyrs : de poésie en délire.
Enfin, avec ironie : Le marché cathare..
En effet l’émission de Stellio Lorenzi à la télévision a fait connaître en 1966 à la France entière ce drame ignoré d’elle. Loin de s’atténuer le succès ne cesse de s’étendre, provoquant un afflux de touristes. . Si cette marée réjouit les occitans, elle peut aussi les irriter, quand elle exploite sans pudeur le catharisme. D’astucieux commerçants la récupèrent, dont parfois les enseignes suscitent l’hilarité.
Les nouveautés conceptuelles.
L’entrée dans le XXIéme s. a été marquée par une prétendue nouveauté, qui en réalité s’inscrit dans l’attitude de déni fortement ancrée depuis un siècle des historiens universitaires. Un colloque à Nice, Inventer l’hérésie ? a promulgué cette assertion : l’hérésie n’existe pas. C’est une invention des cisterciens, qui ont l’ont fabriquée en agrégeant des groupuscules dissidents : le discours des clercs a fait surgir l’hérésie. Ils ont surévalué la menace pour mobiliser le peuple chrétien, peu importe la réalité, l’essentiel est de diaboliser. C’est un artefact : l’hérésie s’est structurée par réfraction. Il n’y a pas d’hérésie en soi.
. Michel Roquebert, licencié en philosophie, a donné aux Mélanges offerts à Jean Duvernoy, Les cathares devant l’Histoire , L’Hydre 2005 un très remarquable article (p.105-153) dans lequel il a décortiqué les présupposés de cette trouvaille Je me bornerai à y ajouter quelques réflexions.
En fait ces historiens ont jugé bon de suivre la mode, en citant les philosophes Foucault, Derrida et Lyotard, pour produire une « déconstruction » des textes – et des textes seuls, sans se poser à leur propos les questions : qui l’a écrit ? Pour qui, et pourquoi ? En appliquant à des écrits médiévaux un système abstrait, sans souci de leur spécificité, ils ont pris le risque de commettre un grave anachronisme. On pense à la phrase d’Antoine Dondaine jugeant des « bonzes » : « il faut lire les textes pour en parler ». Leur défaut initial parait en effet de s’empresser de vouloir affirmer des « nouveautés conceptuelles » (sic) à partir de ce mode de lecture, surtout d’ailleurs d’éditions imprimées. C’est ainsi qu’ils s’en vont proclamant que le mot « cathare » n’a pas été usité au Moyen Age. Il figure dans le ms 933 de la B.M. de Toulouse, écrit vers 1220 et provenant du couvent des Jacobins, sous la rubrique de heresi catharorum,destinée à réfuter cette hérésie. Encore la méconnaissance d’un manuscrit est-elle excusable, malheureusement celui-ci a été édité par mgr C.Douais, O.P., en 1910.
. A l’appui de leur thèse, pour réfuter l’existence d’une église constituée ils nient celle d’une hiérarchie. On a relevé dix-neuf noms d’évêques « cathares », à quoi ils objectent que, pour fabriquer une contre-église les inquisiteurs ont projeté sur la dissidence les titres romains. Mais ceux de fils majeur et fils mineur lui sont propres. Michel Roquebert a constaté que Guilhabert de Castres, fils majeur de l’évêque Gaucelm, lui a succédé, et que Jean Cambiaire, d’abord fils mineur, est devenu son fils majeur. Et que Raimon Agulher, fils majeur de l’évêque du Razès Benoît de Termes, lui succède.
Quant à la dénomination d’église, on peut ne pas accorder d’importance au nom décerné à Montségur de caput ecclesiae, tête de l’église, puisque venant des inquisiteurs, mais le Rituel de Lyon et celui de Dublin emploient le terme : la gleisa de Deù , ecclesia Dei dans celui de Florence. Les Bons Hommes expliquent : l’église, ce n’est pas un monument de pierre, ce sont les croyants. Le Rituel précise : « quand vous êtes devant l’église de Dieu », c’est à dire à l’assemblée. Le catalan Arnaud de Bretos, décrivant en 1242 un culte à Montségur, lui donne ce sens. En fait, ils suivent saint Paul : l’église, c’est le corps mystique. En Aragon et à Arques les croyants prennent d’ailleurs l’expression au pied de la lettre : ceux d’entre eux qui sont utiles à la communauté en sont les pieds et les jambes. Les croyants éprouvent un sentiment profond d’appartenance, qu’ils extériorisent dans le salut rituel aux Bons Chrétiens, et expriment, en particulier lorsqu’ils l’enseignent, comme Arnaud Marty à son petit frère. Et les inquisiteurs ne s’y trompent pas, qui font dire au suspect dans l’interrogatoire, comme preuve de culpabilité, s’il a « adoré les hérétiques ».
La culture hors sol
Le travail du médiéviste, à mon avis, est humble, il consiste essentiellement, dans la lecture des manuscrits, leur déchiffrage parfois, leur compréhension toujours, à chercher leur sens, et trouver la réponse aux trois questions posées plus haut, qui donnent l’intention de l’auteur et déterminent la fonction de l’écrit : théologique, juridique, littéraire, destiné à un public lettré ou populaire. Mais il faut aussi chercher, entre les lignes, à le replacer dans l’esprit et la mentalité de son temps
Or, ces « déconstructionnistes » se sont emparés de la théorie de la déconstruction de Derrida et l’ont appliquée à des manuscrits médiévaux auxquels elle reste étrangère. Ils les prennent comme s’il s’agissait d’un texte contemporain : un produit en soi .La finalité de l’œuvre les laisse indifférents : avant la Croisade les polémiques ont été rédigées pour servir lors des controverses en public, et quand il s’agit de procès d’inquisition, il n’est pas anodin de se souvenir de leur caractère juridique, qu’ils sont une étape dans une procédure, et conduisent à une sentence, qui peut être de mort, ou de prison perpétuelle, voire de port de croix, lesquelles entraînent la confiscation des biens et donc la ruine de leurs proches. Il est vrai que l’un de ces estimables collègues s’écrie : « l’inquisition est une impasse de l’histoire ». Alors, pourquoi s’égarer dans cette impasse ? Peut-être pour ne prêter attention qu’à l’inquisiteur, et à lui seul, comme auteur de l’écrit. Celui qu’il interroge existe si peu que G.Zanella le qualifie d’ « insignifiant fortement réactif ». En effet, au mépris de toute vraisemblance, le bienheureux historien croit fermement, et l’explicite en charabia cuistre , que « avec la torture la progressive simplification conceptuelle de la procédure touche à son maximum » ( signalons au passage que l’usage de la torture était interdit aux clercs – lesquels d’ailleurs employaient des procédés plus subtils) pour aboutir à ce paradoxe : « les membres du tribunal recherchent des aveux conformes à leur système de références et l’accusé, en situation de faiblesse, a toutes les chances d’adhérer aux schémas qui lui sont proposés et de dire la vérité de ses accusateurs ». Zanella pense donc que les procès d’inquisition ne sont rien d’autre que l’enregistrement des fantasmes de l’inquisiteur. En d’autres termes il n’a pas lu les Manuels de l’inquisiteur. De Raimon de Penyafort en 1245 à Nicolas Eymerich, XIVéme s. en passant par Bernard Gui,fin XIIIéme s. ils décrivent les « hérésies nouvelles », modifient leur questionnaire par rapport à elles, en affinent la psychologie, et détaillent les procédés à utiliser pour arriver à leur but : l’aveu. Car ils veulent la vérité, et la vérité ancrée dans le réel des faits « criminels ». Répéter la vérité de ses accusateurs signifierait obéir au « syndrome de Stockholm ». Or, dans les procès-verbaux, la personne du juriste s’efface au point qu’ils ne consignent en général que les réponses du témoin, non les questions. On les perçoit lorsqu’on lit attentivement les procès-verbaux d’inquisition, en suivant les méandres des interrogatoires et relevé, parfois savouré, les astuces du « témoin » pour se défendre. La déconstruction nie sa personnalité, son existence même. L’humain a disparu.
Mensonges en Lauraguais
Comme il a disparu de l’étude sur les enquêtes en Lauraguais. Menées systématiquement de village en village, elles faisaient comparaître toute la population devant le tribunal itinérant, les filles à partir de douze ans, les garçons à partir de quatorze –âge sans doute de la puberté, mais réjouissant aveu implicite de la maturité féminine. Jean Louis Biget, après avoir compulsé le registre d’inquisition à Albi de 1299 (édité par G.W. Davis, en 1950) en a tiré la conclusion qu’à cette date seuls 3 à 4% des habitants étaient encore adeptes de l’hérésie, et trouvé faible la proportion. Il nous semble au contraire qu’après plus d’un demi-siècle d’inquisition elle manifestait un singulier attachement.
L’albigeois d’adoption a alors appliqué sa « méthode » au registre du Lauraguais, ms 609 de la B.M. de Toulouse ( qu’avec son habituelle générosité, Jean Duvernoy a mis en ligne), a établi des statistiques et parvenu au même résultat : la proportion d’hérétiques restait faible. Jean Louis Biget a pris pour argent comptant ce que consignait l’inquisiteur, qui, lui, n’était pas naïf : l’enquête avait été décidée parce que la terre de Lauraguais était considéré comme totaliter corrupta : totalement corrompue : il était donc invraisemblable qu’un village entier défile devant le tribunal en affirmant à l’unisson ne rien savoir de l’hérésie. En continuant à consulter le registre, on s’aperçoit que quelques années plus tard, l’inquisiteur revient dans le village, et cette fois le ton a changé. Hostile, devant les étrangers il avait observé l’omertà. Que s’est-il passé entre temps ? il faut lire entre les lignes pour deviner le travail de sape, les pressions exercées pour obtenir l’aveu, qui surgit enfin : le plus faible a cédé, et parle : dans la file des habitants protestant de leur innocence, mêlés à eux, avaient témoigné les Bons hommes qu’ils abritaient, et qui, la seconde fois, dénoncés, avaient fui. Ceci s’est passé, par exemple, aux Cassès. On remarque d’ailleurs que plus le village est escarpé, mieux il se défend, ainsi à Montmaur. Un castrum devait se sentir davantage en sécurité. Mais l’inquisiteur a d’efficaces moyens de persuasion. Il réussit à mettre à jour des pactes de silence. Démasqué, le premier donne le groupe. Tout s’écroule. En quatre ans les défenses sont anéanties, les croyants en prison ou en fuite. On peut supposer tout de même que des chanceux ou des rusés ont échappé à la nasse, comme les rescapés de l’enquête de Geoffroy d’Ablis débusqués par Jacques Fournier.
.Les villageois du Lauraguais sont contemporains des défenseurs de Montségur. Ils ont vécu l’éphémère victoire de Bazièges, se sont réjouis du raid d’Avignonet, dont le but réel était la disparition des périlleux registres les mettant en danger. Mais voilà revenus les inquisiteurs, plus forts qu’avant. Ils démolissent patiemment, inéluctablement, tous les mensonges avec ruse amassés. Dans le registre se lit l’effondrement de la terre autrefois rebelle.
On doit donc y lire en perspective l’avancée de l’inquisition, non à plat en prenant au pied de la lettre des affirmations auxquelles l’inquisiteur ne croyait pas. Cette bévue, qui en fait l’équivalent d’un quelconque document administratif moderne, dérive de la volonté de décalquer un système philosophique sur les sciences humaines. Dans le troisième quart du XXéme s. elles ont adopté le cours de linguistique de Saussure et ont bâti le structuralisme en le transposant avec succès, comme Lévi-Stauss en ethnologie, dans des disciplines différentes. Il est passé de mode. Puis elle s’est tournée vers le déconstructionnisme. Derrida a avec finesse décortiqué des textes, mais des textes de philosophie ou de fiction, déconnectés de la réalité et des faits. Ceux-ci sont la matière de l’histoire. Ses écrits transmettent un passé qui a existé, été vécu. Les interpréter en l’ignorant aboutit à les dénaturer. ‘
.Pour finir, j’aimerais qu’on m’explique comment un certain Ermengaud, vaudois converti en 1208, a pu devenir en 1179 abbé de St-Gilles. Et j’avoue trouver piquant d’être contestée au nom de J.F. Lyotard, avec lequel j’ai cosigné un livre aux P.U.F.
Foucault, Derrida, Lyotard, sont morts. Saussure aussi, et Lévi-Strauss. On attend l’arrivée d’une nouvelle mode intellectuelle, et celle d’une génération qui s’en inspirera pour fabriquer des trouvailles inédites. Alors passeront aux oubliettes les actuelles « nouveautés conceptuelles », comme sont oubliés le marxisme de Morghen et le bûcher de Bram.
On s’en voudrait cependant d’oublier de remercier le groupe des déconstructionnistes pour leur langage, qui charrie un humour involontaire. La palme revient peut-être à leur désir, par ailleurs significatif de leur démarche, d’atteindre… « l’hologramme de l’inquisiteur implicite » ©Annie Cazenave
Notes (ndrl-Wiki)
* Jacqueline de Romilly (1913-2010), est une philologue, femme de lettres, professeur et helléniste française.
Membre de l' Académie française, première femme professeur au Collège de France, elle est connue sur le plan international pour ses travaux sur la civilisation et la langue de la en particulier à propos de Thucydide objet de sa thèse de doctorat.
* * Thucydide(465– 400 av. JC) est un homme politique et historien athénien Il est l’auteur de La Guerre du Péloponèse, récit d'un conflit athéno-spartiate qui se déroula entre 431 av. J.-C.et 404 av. J.-C.Thucydide est un véritable historien au même titre qu'Hérodote au sens où il rationalise les faits et explore les causes profondes des événements, en écartant tout ce qui procède du mythe ou de la rumeur. Pour lui, la qualité fondamentale de son métier est l'exactitude, qui implique l'impartialité, et son premier devoir consiste donc à rechercher la vérité. Lui-même expose d'emblée sa méthode en expliquant le soin qu'il a mis à recueillir tous les documents, tous les témoignages, et à les comparer pour en tirer ce qu'ils contenaient de vérité.
------------------------------------------------------------------------------------------ Mars 2018
Sources évoquées dans l’article d’Annie Cazenave (ndrl/patr.d) :
« RENCONTRES DE MONTSEGUR Les Cathares face à l’Histoire, des rebelles ou des résistants ? » © Annie Cazenave
Par ordre d’apparition à l’écran
Napoléon Peyrat Histoire des Albigeois
Dom Claude De Vic et Dom Joseph Vaissette Histoire générale du Languedoc
Pierre Belperron La Croisade contre' les Albigeois, et l'union du Languedoc à la France. 1209-12^9. — Paris, Pion, 1942; In-8°
Charles Petit- DutaillisLa monarchie féodale en France et en Angleterre, xe – xiiie siècle, Paris, la Renaissance du livre, 1933.
Charles Camproux(Lire de Philippe Martel : Charles Camproux, un non-conformiste des années 1930)
Louis Xavier de Ricard L'Esprit politique de la Réforme., Paris, Fischbacher, 1893.
Félibres rouges et « l’escolo de Mountségur » Foix, Ed. Jean Gadrat.
Yves Dossat « Les crises de l’inquisition toulousaine, 1233-1273 » Bordeaux, 1959 - « Église et hérésie en France au XIIIe siècle » Variorum, 1982.
Norbert DoatT.XXXIV de la collection Doat - fonds Doat de la Bibliothèque nationale
Maurice Magre « Le sang de Toulouse » « Le trésor des Albigeois » Ed. Fasquelle
Hans Sôderberg, qui a bénéficié des travaux d’Henri-Charles Puech, a passé en 1959 sa thèse, rédigée en français, sur « La religion des cathares. Etude sur le gnosticisme de la basse antiquité et du Moyen-âge ».
Henri-Charles Puech « Histoire des religions » Ed. Gallimard 1999
J. Duvernoy article « Origène et le berger » et extraits de dépositions des procès verbaux d’inquisition : Prière de Jean Maury in Registre d’inquisition de Jacques Fournier (1318-1325) publié à Toulouse Ed. Privat avec le concours du C.N.R.S.(1965)
Simone Pétrement «Le dieu séparé» -1985.
René Nelli « Ecritures cathares » La Cène secrète : Le Livre des deux principes : Traité cathare : Le Rituel occitan : Le Rituel latin : textes précathares et cathares présentés, traduits et commentés avec une introduction sur les origines et l'esprit du catharisme (1959) (Monaco, éd. du Rocher, 1994. Des Cathares du Languedoc au xiiie siècle, Paris, Hachette, 1969
L’érotique des troubadours, Toulouse, Privat, 1963 (rééd. dans 10/18 - 2 tomes - 1974 ; Privat, 1984)
Le Phénomène cathare - perspectives philosophiques, morales et iconographqiues (1964), Toulouse, Privat, 1988.
Le Roman de Flamenca, un art d'aimer occitanien au xiiie siècle, Toulouse, Institut d'études occitanes, 1966
Fernand Niel « Montségur », «Albigeois et Cathares » Que sais-je ? P.U.F réed. 2010
Ignaz von Döllinger « Beitrage zur Kirchengeschichte“ 1878
Michel de Certeau La Fable mystique : XVIe et xviie siècle, Paris, Ed. Gallimard, 1982 ; rééd. 1995 et Tome 2, à Paris, Gallimard, 2013.
Le Voyage mystique : Michel de Certeau, sous la dir. de Luce Giard, Paris, Recherches de sciences religieuses, 1988.
Raoul Manselli La Religion populaire au Moyen âge : problèmes de méthode et d'histoire, Montréal-Paris, Institut d'études médiévales Albert-le-Grand-J. Vrin, 1975- l’Eresia del male
Antoine Dondaine publication en 1939, sous le patronage de l’Institut historique dominicain, du Livre des deux principes (Liber de duobus principiis)
Arno Borst Les Cathares (= Monumenta Germaniae Historica. Fontes. Vol. 12, ISSN0080-6951). Hana, Stuttgart, 1953 (nombreuses éditions ; en Français : Les Cathares. ) Ed. Payot, Paris, 1984, ISBN 2-228-11421-9).
Christine Thouzellier Etude : Livre cathare des deux principes Paru en février 1988) et Etude : Rituel cathare Paru en février 1987
Franjo Šanjek Les chrétiens bosniaques et le mouvement cathare au moyen, Paris-Louvain 1976
Emmanuel Le Roy Ladurie Montaillou village occitan, de 1294 à 1324.
Paris. Ed. Gallimard, 1975. In-8°. (Bibliothèque des histoires.)
Michel Roquebert Citadelles du Vertige - photographies de Christian Soula. (Toulouse, Imprimerie Régionale, 1966. Réédition par les Éditions Privat en 1972)
l’Epopée cathare ( 1970-1998),Réédition intégrale, revue et augmentée, de L’Épopée cathare en 5 volumes (Paris, Perrin, Collection Tempus).
Les cathares devant l’Histoire , L’Hydre 2005 article (p.105-153)
Les Figures du catharisme Ed. Perrin 2018
Arnaud de Bretos Deposició d’Arnau de Bretós, veí de Berga acusat d’heretgia, davant l’inquisidor Ferrer de VilarojaData:12 de maig de 1244 ciutadella de Montsegurhttp://www.alturgell.cat/deposicio-d%E2%80%99arnau-de-bretos-vei-de-berga-acusat-d%E2%80%99heretgia-davant-l%E2%80%99inquisidor-ferrer-de-vilaroja
Joë Bousquet, Les Cahiers du Sud (1914-1966) « Le génie d’Oc et l’homme méditerranéen »
Marie Humbert Vicaire, Etienne Delaruelle, les Cahiers de Fanjeaux
Raffaello Morghen 1968 - colloque dirigé par Jacques Le Goff à Royaumont sur « Hérésie et société dans l’Europe pré-industrielle »
Yves Rouquette Cathares. Toulouse, éditions Loubatières, 1991
Claude Marti Montségur ! (Ventadorn) Terres Cathares (chemin faisant), illustrations de Paul Moscovino, 2007, Études & Communication Éditions
Centre d’Etudes cathares/René Nelli1998 in 7éme colloque « Catharisme, l’édifice imaginaire »
Stellio LorenziLes Cathares1965 France-Télévision in
« La caméra explore le temps » de Stellio Lorenzi André Castelot et Alain Decaux
G.Zanella https://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Zanella
Raimon de Penyafort Manuel de l’inquisiteur - Summa juris canonici (1221)
Nicolas Eymerich Manuel de l’inquisiteur Directoire des Inquisiteurs (Directorium Inquisitorum), adapté par Francisco Peña en 1578 et partiellement publié en français sous le titre de Manuel des Inquisiteurs, manuel juridique dans lequel il explique l'origine, les droits et les procédés de l'Inquisition.
Bernard Gui Manuel de l’inquisiteur - Practica Inquisitionis hreticae pravitatis, rédigé entre 1319 et 1323. - Liber sententiarum (Livre des sentences) recueille les actes de 11 sermons généraux (appelés sermo generalis) et ses 916 décisions de justice prises, pendant son mandat d'inquisiteur à Toulouse, contre 636 personnes (décisions individuelles ou concernant toute une communauté)
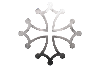
NAPOLEON PEYRAT
et
MONTSEGUR
LE POETE DE L’EXIL © Annie Cazenave
Napoléon Peyrat eut un destin curieux, celui du découvreur éclipsé par sa découverte. Qui, aujourd’hui, se souvient que si Montségur existe c’est grâce à lui ? Parmi les files de touristes gravissant le sentier montant au château combien ont lu l’Histoire des Albigeois ?
Annie Cazenave, historienne médiéviste, reprend sa biographie en suivant le fil que lui-même a déroulé. Ses Notes biographiques, rédigées en 1876, ont été publiées dans le colloque Cathares et Camisards, L’œuvre de Napoléon Peyrat (1809-1881), sous la direction de Patrick Cabanel et Philippe de Robert, préface de Philippe Joutard, Toulouse, 1992, p.22-32. Ce texte est sensiblement celui qu’elle a prononcé, entrecoupé des poèmes de Peyrat, lus par Olivier de Robert, conteur et écrivain ariégeois (http://olivierderobert.net) lors de l’Assemblée Générale des Amis de Napoléon Peyrat, le 7 août 2008, dans le temple des Bordes-sur-Arize (09350 - https://www.museeprotestant.org)
Alors pasteur à St-Germain en Laye il revenait sur sa jeunesse, donnant ainsi la source de son inspiration : « notre maison de Reb-Alion, toujours retentissante d’aventures, de martyre, de guerre, de bergeries, fut mon premier gymnase d’histoire et de poésie ». Il écrit Reb-Alion, en donnant pour étymologie Ripa-leonis, pour Ribaillou, sa maison natale, « débris de l’antique Ramos romaine, un village de vignerons, de vaches, d’ânes, de porcs, de canards, sur la rive droite de l’Arize ». Orphelin de mère à l’âge de trente mois, en 1811, il perdit en 1813 son frère Narcisse, mis au monde par sa mère morte en couches.
« Orphelin triste et doux, blond, plaintif et sauvage Arise je grandis sur ton triste rivage ».
Il quitta l’Ariège à quatorze ans, mais les impressions d’enfance furent si vives qu’il puisa en elles toute sa vie. Il fut à la fois poète et historien. La guerre lui inspira son premier poème, Roland, publié en 1833 et signé du pseudonyme de Napol le Pyrénéen. Il y mêle Charlemagne et Napoléon, car l’épopée à ses yeux est l’épopée napoléonienne : à Rébaillou «On parlait de la Révolution, de ses grands tribuns, de ses grands héros, mais on revenait toujours au plus grand : Napoléon »
Nos pères, du soleil et du canon bronzés
Sont morts aussi, mordant leurs vieux sabres usés,
Sur tous ces rochers de l’Espagne…
Lève toi pour les voir, lève toi vieux lion
Plus grande que ton oncle et que Napoléon
Viens voir la liberté qui passe.
En 1814 la Terreur blanche poursuivit son grand-père, maire des Bordes, « il fut proscrit comme Napoléon et se cacha dans les bois de Larmissa. On hurlait après les protestants. On tirait de nuit des coups de fusil dans nos volets ». Ces impressions d’enfance le firent partir toute sa vie en quête des proscrits, des fugitifs, des martyrs pour leur foi. Elles furent encore amplifiées lorsqu’en 1817 on le mit à l’école au Mas d’Azil : l’arche de granit, le temple sombre, le parvis colossal vont hanter son imaginaire. Enfant unique et orphelin, élevé par des tantes, il semble ne pas avoir eu de compagnon de jeu. C’est donc en solitaire qu’à 8 ans il s’est aventuré, escaladant les rochers de la rive, une lanterne à la main, dans les ténèbres. La grotte n’était pas encore traversée par la route, et la préhistoire dans les limbes. La Spélunque superbe est donc toute entière vouée au souvenir des prêches au Désert, et du jour
Où sur tes grèves
Flamboyait dans nos camps le char de l’Eternel…
Et il évoque le siège du Mas d’Azil, dont son aïeul Pierre Peyrat est l’un des sept défenseurs :
Ecoutez ! Thémines s’élance !
Caraman, Ventadour et leurs noirs bataillons
Campent sur nos rochers où la mort se balance,
Jouant dans les lis d’or de leurs noirs pavillons….
Trois siècles de héros sous la roche dormants !
Vieille Bible de roc, granitique épopée,
Où trois fois nos aïeux, par la croix et l’épée,
Confessèrent l’Etre un, unique, universel…
…Un seul Livre, un seul Christ, un seul Dieu, l’Eternel !
…Et tout un monde obscur se leva du néant : ce vers annonce son œuvre future !
En 1823 il va continuer ses études à Châtillon sur Seine, auprès de Jacques-Paul Rossellotti, pasteur et chef d’institution. Il y trouve beaucoup de livres, lit Boileau, et les premières poésies de Lamartine et Hugo, et achète un Racine à un petit libraire ambulant, il en est enivré, et sa façon de l’exprimer montre à quel point il mêle l’histoire protestante et la Bible : «je fus enivré des chœurs d’Esther surtout, cette époque de la Révocation et de notre exil de Babylone ». Les Psaumes lui inspirent en effet, d’abord une paraphrase mettant les versets en français, mais surtout des poèmes où la trame biblique sous-tend le souffle épique du style, lui offre une évocation à la fois antique et actuelle, ainsi, inspiré du ps 137 :
Super flumina
Sur les fleuves de Babylone
Nous nous sommes assis dans notre affliction
Nos pleurs tombaient dans l’onde qui bouillonne
Car nos cœurs pensaient à Sion
Nous avons suspendu nos harpes
Au rameaux chevelus des saules de leur bord.
Nos vainqueurs triomphants aux splendides écharpes
Le front ceint de tiares d’or,
Nous ont dit : captifs hébraïques
Relevez donc vos fronts, reprenez le nébel
Chantez, et faites nous entendre les cantiques
De Sion aux fêtes de Bel
Qui ? nous ! Chanter sur cette terre !
Nous, chanter dans l’exil ! Nous, enfants de Juda !
Ah ! si je t’oubliais, ô Salem, ô ma mère,
Sanctuaire de Jéhova !
…
Ô Babel, lève tes paupières,
Vois l’exterminateur foudroyer tes remparts,
Et tes petits enfants broyés contre les pierres
Comme le faon du léopard !
Selon Ph. de Robert : « il y trouve une grille de lecture personnelle de la réalité, permettant de déchiffrer les énigmes de l’histoire aussi bien que les mystères de l’univers, mais aussi un mode d’expression capable d’en communiquer le sens à ses contemporains et de faire de toute histoire humaine un fragment d’histoire sainte » (o.c., p.193). C’est là, me semble-t-il, la clé de son œuvre, mais aussi la raison pour laquelle il resta incompris de ceux qui ne partageaient pas son souffle épique.
Le 1er novembre 1825 il entra à la faculté de théologie de Montauban. Il y resta 5 ans et 5 mois, et soutint sa thèse de théologie le 21 février 1831. C’est à Montauban qu’il vécut la Révolution de 1830 qui «me remplit du plus ardent enthousiasme ».
«Je revins dans l’Ariège. J’embrassai mes parents. Je dis adieu à nos montagnes et j’allai chercher fortune à Paris…Qu’allais je faire à Paris ? Fouiller les chroniques et me mêler aux poètes. Mes livres : ce ne sont pas des livres, mais des actions. Ce sont des batailles et des martyres. Je me suis rué au milieu des épées et des échafauds. Je suis tour à tour albigeois, calviniste, girondin. J’ai en horreur les buveurs de sang, qu’ils s’appellent Marat, Baville et Montfort, et si nous en sommes rouges, c’est du nôtre »: il désigne ainsi ceux dont, sa vie durant, il a pris le parti !
Car, en histoire, il veut partir à la recherche de ses aïeux, par le sang et par la foi. Il revendique sa descendance d’Albigeois : un Peyrota, diacre au château de Dun près de Pamiers, aumônier de la comtesse de Foix, et précepteur de Roger-Bernard. Et Ramond de Peyrela (c’est à dire Péreille) est un des défenseurs de Montségur. A la vérité, rien ne prouve que les patronymes qu’il retrouve dans les procès d’Inquisition soient à l’origine du sien. Il affirme : « les Peyrat formaient, comme un clan d’Ecosse, une tribu mêlée de familles chevaleresques et plébéiennes , et c’est d’une de ces dernières que je pense être descendu ». Mais il semble avoir subi l’influence de son oncle Auguste, « le savant de la maison déclarait que nous étions des proscrits, des déshérités…il citait des noms, désignait des lieux ; noms et lieux étaient apocryphes ». Ces rêveries ont cependant imprégné l’imaginaire de l’enfant, et persisté dans l’adulte, malgré leur absence des textes. Il résout sans hésiter – et d’ailleurs sans la voir- la question qui laisse perplexe, et divise, les historiens : les cathares sont-ils les ancêtres des huguenots ? Pour lui, il s’agit, non de doctrine, car en 1855 il voit en Vigilance l’aïeul des Réformateurs, mais d’une filiation de persécutés : le souvenir de la Révocation et des galères était très vif au Mas, où il s’y perpétue, il assimile donc les condamnés de l’Inquisition à ceux du Roi, du « Bourbon », qu’il déteste !
Jugeant (à juste titre !) que cette histoire albigeoise est embrouillée et obscure, il commence par ses ancêtres par la foi : il rédige une Histoire des Pasteurs du Désert. En août 1837 il entreprend un voyage dans les Cévennes lozériennes, et son livre parait en 2 volumes en 1842. Dans la droite ligne des traditions orales entendues aux Bordes, il va en Lozère respirer le même climat.
Mais, ô Sinaï des Cévennes
Ta cime épanche encore de plus fécondes veines ;
L’une un fleuve de foi dont la source est au ciel,
Jourdain mystérieux dont les tribus bibliques
Habitent les bords symboliques
Où s’abreuvent sans fin les bercails d’Israël
Mais il se trouve en porte à faux envers certains protestants, du moins ceux qui appartiennent au Réveil, qui, à son avis « pétrifie les cœurs ». Car, étudiant l’histoire huguenote dans une perspective rationnelle, ce courant se trouve donc gêné par « les moments enthousiastes et fanatiques de la résistance huguenote », comme l ‘écrit M.Jas, estimant que le livre de Peyrat aurait dû s’appeler « Histoire des camisards et prophètes du Désert ». Il est déçu, et il déçoit. Mais dans son camp.
En 1850 Henri Martin, dans son Histoire de France, juge : « il n’a pas seulement restauré les épitaphes de ses héros, il les a fait sortir vivants de leur sépulcre ». Et Michelet : « son livre a un mérite unique, que les contemporains n’ont point, c’est qu’il donne le sol, le paysage, la nature, où le combat se passe. Il vit du souffle même et du génie de la contrée ». Mais l’éloge le meilleur, et le plus mérité, est sans aucun doute celui de notre contemporain Ph. Joutard, qui, cévenol, a entrepris dans sa thèse de confronter les archives à sa propre tradition, et constaté qu’elles concordaient. Il a donc rendu hommage à son prédécesseur : « il n’a sans doute pas inventé les Camisards, car les cévenols, mais aussi les protestants méridionaux, n’ont jamais oublié ce qu’ils leur devaient, et ils l’ont dit à travers une tradition orale vivante qui se moquait d’une historiographie réformée très majoritairement négative. Mais, issu de cette mémoire orale et accédant par ses études au monde réformé savant, il a rallié la mémoire savante à la mémoire régionale et « populaire » sous la double influence du romantisme et de la fidélité à ses origines ». On s’efface devant la pertinence et la profondeur de ce jugement, qui a apprécié l’originalité de l’Ariégeois, lisant les textes à travers sa personnalité propre, et reconnu en lui un précurseur. Ph. Joutard associe le vieux pasteur à la forme la plus nouvelle de l’histoire, l’histoire soucieuse des mentalités et des hommes. Lui-même définissait ainsi son écriture de l’histoire : « les empailleurs de rois, les embaumeurs de pharaons, détestent cette manière d’écrire l’histoire, vivante, saignante, hurlante ».
Hélas c’est eux qu’il va affronter lors de la parution en 1876 de son Histoire des Albigeois. Il a travaillé trente ans à cette résurrection, rédigée à partir de documents encore inédits, c’est à dire le registre d’enquêtes en Lauraguais, ms 609 de la Bibliothèque municipale de Toulouse, dont il a consulté, et même annoté de sa grosse écriture, la transcription partielle, le ms 169, et, à la B.N la collection Doat, copie ordonnée au XVIIéme s. par l’intendant Doat, de documents principalement médiévaux, en particulier les procès-verbaux de l’Inquisition. Le t. XXIV, surtout, contient les dépositions des prisonniers après la chute de Montségur : « je cherchais le tombeau de mes ancêtres. Je l’ai trouvé en découvrant Mont-Ségur et le monde albigeois. J’errais pendant trente ans dans cette nuit. Je naviguais en tâtonnant dans cette mer de pleurs et de sang ».
Ici, une incidente paraît d’autant plus nécessaire qu’elle est émouvante : son père veuf et brouillé avec sa belle-famille vivait dans sa propriété de Larmissa, sur une hauteur boisée dépendant de la commune d’Artigat, d’où le regard porte au loin, découvrant d’un côté le pic de Nore, de l’autre le St-Barthélemy et un pic, dont le triangle se profile clairement sur le relief bleuté des montagnes, et qui se nomme …Montségur. Napoléon enfant a donc vu le pog, sans peut-être savoir son nom, mais n’a pas pu ne pas être intrigué par sa forme. Sa première expédition, relatée dans une brochure de sa femme Eugénie, date de 1867. Et c’était en ce temps toute une aventure que de parvenir jusqu’au village, sans route, en carriole par de mauvais chemins de montagne, et d’affronter, à l’inverse de la mémoire cévenole, l’indifférence des habitants, qui se servaient du château comme d’un commode réserve de pierres. Le mérite, éminent, de Napoléon Peyrat a été d’associer le site et son histoire. Révélés par les interrogatoires des vaincus, le siège de Montségur et le bûcher ont été traités par lui comme un martyrologe.
En cela aussi il est original – et méconnu : il a su déchiffrer le langage juridique du Tribunal d’Inquisition, et en retourner les chefs d’accusation pour retrouver à travers eux la réalité des vaincus. Mais il arrive à contretemps. Fidèle au romantisme de sa jeunesse, il publie ce livre au moment où les historiens, impressionnés par le prestige des scientifiques, en particulier les théories de Claude Bernard, se piquent d’élever leur métier au rang de science, d’en donner une méthode, d’élaborer une histoire critique, reposant sur la raison et se flattant d’objectivité. Comble d’infortune, à la suite de Renan et de Taine, ce courant de pensée séduit surtout les protestants libéraux. Gabriel Monod veut bâtir « une science positive » et c’est Albert Réville, ancien pasteur, fils et frère de pasteurs, irrité par le lyrisme, qui se charge d’administrer dans la Revue des Deux Mondes une volée de bois vert. A la critique, (fondée !) de « se laisser aller à la manie de l’étymologie » il associe celle de négliger « les règles de la science moderne » : aligner des faits, des citations nombreuses, des comparaisons de textes et des preuves, et assène : « ce n’est pas ainsi qu’on écrit l’histoire ». Le normand Réville extrapole en identifiant en Peyrat le méridional, dont la « vanterie perpétuelle » est explicitement étendue à tous les habitants du bassin de la Garonne.
A vrai dire, au sujet des Albigeois –ou cathares – le conflit est récurrent. Il semble que certains historiens aient à cœur de se réfugier dans une attitude hypercritique – par souci de se démarquer de la sympathie envers les « hérétiques », jugée partiale et populaire, par répugnance à mettre en relief l’horreur ? Dans les années 60 Y. Dossat a fait une découverte d’importance : à partir d’un seul texte, pour comble un vidimus, il a affirmé qu’il n’y avait pas eu de bûcher à Montségur. Il s’était passé à Bram. E.Delaruelle, en général mieux inspiré, lui a emboîté le pas. Il a été facile de leur opposer des documents, nombreux, portant la précision : le bûcher a eu lieu ibi. Ibi signifie : là, ici, et non à quarante kilomètres ! Et de toute façon, c’est le bûcher lui-même qui fait problème ! L’affaire est enterrée, et oubliée. La contestation contemporaine a pris une nouvelle tournure : puisque les documents émanent de l’autorité, on ne peut s’y fier : ils ne reflètent qu’elle même, et les hérétiques (dont le nom de cathares est erroné) sont une création de l’Inquisition. Pourquoi pas ? Les Résistants fredonnaient: On nous appelle les réfractaires, les terroristes, les hors la loi…Les clandestins pourchassés étaient eux aussi des hors la loi. Or, la critique des sources est une des méthodes de l’histoire, dont parfois même il n’est pas besoin, le bon sens suffit. Et si l’Inquisition est une « impasse de l’histoire » vouloir l’étudier semble bizarre, voire masochiste. Certains ont le culte de l’autorité, fût-elle ecclésiastique, et le goût du pouvoir. Les voir se glorifier d’appartenir à l’Université, quand on en est à déplorer ses décombres, est de l’humour noir. Réville, au moins, écrivait une belle langue. Bof ! Dans vingt ans, ces cuistreries auront rejoint aux oubliettes le bûcher de Bram.
Décrié par les scientistes, le chantre de Montségur a été admiré des siens, écrivains et poètes méridionaux. Ils ont été sa postérité, et sa revanche. Ce sont les Félibres rouges, branche occitane du Félibrige né sous l’impulsion de Mistral. A Toulouse et Montpellier, mais aussi à Foix, groupés autour de L.X. de Ricard, les Félibres républicains, dits rouges, veulent la Renaissance de l’Occitanie et de sa langue, et ils l’ont choisi pour aujol, aïeul. Le Félibrige rouge naît en 1876. Dans l’hiver 1876 L.X.. de Ricard rencontre Peyrat à Paris, où les félibres vont éditer la revue La Cigale, et à Montpellier il lance La Lauseta. Peyrat, sous le pseudonyme de Lou Pirenean, y publie un poème dédié à Dona Graciorella Milgrana, felibressa de La Lauseta (St-Germain, 9 janvier 1877) c’est à dire à Lydie de Ricard, dont c’est le pseudonyme. Cette unique pièce en oc révèle une inspiration toute différente, gracieuse, courtoise, un poète sensible et délicat.
Napoléon Peyrat, comme tous ceux de son temps, était bilingue, et il l’écrit dans ses Mémoires : « la langue romane était mon idiome habituel, je n’ai pas oublié cette douce langue natale et maternelle, proscrite par Rome comme hérétique avec les albigeois, les héros, les martyrs ». Mieux, il relate que le petit groupe ariégeois de Châtillon sur Seine auprès de Rossellotti l’employait couramment : «Notre corps était au bord de la Loire, mais notre âme était aux montagnes natales. Nous nous consolions en parlant notre belle langue romane, la langue martyre ». Pourquoi martyre ? Parce que Rome l’a proscrite ! Et donc elle est « un idiome », et il compose en français, la langue du culte et de Clément Marot, n’imaginant pas en 1830 qu’il puisse en être autrement. A la fin du XIXéme s. encore, la grande majorité du peuple était analphabète et donc ne parlait que patois. Le pasteur Emilien Vieu, au Mas d’Azil, prêchait en patois. Dans un cantique de Noël les anges parlent en français aux bergers, qui répondent en patois. C’est Mistral qui vers 1870 veut redonner au provençal sa fierté, et publie en 1875 Lis isclo d’or. Mais ce mouvement a pris naissance grâce aux romanistes, qui ont mis au jour et publié les œuvres des troubadours. Raynouard et Fauriel ont permis aux Méridionaux de les connaître et donc de prendre conscience que leur langue avait été littéraire, et pouvait renaître à la littérature. Il ne s’agit plus de patois, mais de langue romane. Le montalbanais Mary-Lafon révéla les romans médiévaux, Jaufre, Flamenca, et l’épopée de La Canso de la Crosada. Nous y voilà. C’est le thème de la Croisade qui va donner leur inspiration aux poètes languedociens. Les Occitans sont reconnaissants aux Provençaux d’avoir réveillé leur langue, et respectent Mistral, mais ils ont un tout autre esprit, républicain et souvent protestant, en tout cas anticlérical. Et ils leur reprochent de rêver à l’Avignon des Papes. A. Fourès, sur une épée trouvée à Fanjeaux par un laboureur, compose une ode dédicacée à N.Peyrat, qui le remercie d’avoir composé « un sirventès de Figueiras et de Bertrand de Born, et termine sa lettre : « Abalisco Mountfort, lou Tuadour ! Abalisco Doumenge, lou Crémadour ! Mes à bous autris, laousetos et palombels del Miejoun renascut, Gracios et Amistanço » (A bas Montfort, le tueur ! A bas Dominique, le brûleur ! Mais à vous, alouettes et palombes du Midi renaissant, grâces et amitié). Fourès inaugure « la littérature de Montségur », et termine un sonnet A n’Napol le piranean qu’il compare à Roland : soufflant du cor pour réveiller l’histoire :
Quan emplena d’alen la trompo lugrejanta
Aquo’s tu, grand aujol, mestre a l’ama giganta
Guillaume de Turdela et Guilhabert de Castras !
E mai bèl que Rotland, a ta boca l’enclastras
E l’tieu buf eroic i ronfla bèlamant
(Quel est celui qui emplit de souffle la trompe scintillante ? / C’est toi, grand aïeul, maître à l’âme gigantesque /C’est toi en qui font leur superbe renaissance / Guillaume de Tudèle et Guilhabert de Castres / Et, plus beau que Roland, à ta bouche tu l’enchâsses / et ton haleine héroïque y ronfle bellement)
Ils rivalisent de lyrisme pour « la défense de la patrie romane », glorifient la toulousaine dont la pierre lancée des remparts tua Simon de Montfort (une plaque indique l’endroit) et inlassablement célèbrent Montségur.
L.X. de Ricard, dans sa présentation posthume des Mémoires, répondant à Réville, constate : «l’érudition n’est pas tout, et si l’art de cataloguer les faits est précieux, l’art qui les fait revivre est autrement précieux, parce qu’il est autrement rare », et caractérise l’inspiration des Félibres rouges : «Napoléon Peyrat rêvait, comme nous, toute la Renaissance du Midi, je dis toute, c’est à dire la Renaissance dialectale et littéraire, autant que la Renaissance politique. Venu avant la Révolution qui, selon lui, a réconcilié dans le droit nouveau la France du Midi et la France du Nord, il eut été séparatiste. « Le Languedoc, a-t-il écrit, a été la Pologne des Capétiens ».
La Pologne démembrée et meurtrie, cette comparaison est parlante. Et donc les félibres revendiquent leur passé, qui les affermit dans leur identité, et prennent Montségur pour symbole à la fois de leur tombeau et de leur berceau. Montségur devient le mythe fondateur de la patrie romane ressuscitée. Napoléon Peyrat renchérit : c’est la sortie d’Egypte, le réveil de la fille de Jaïre, qui sort de son sépulcre en chantant. «Renaître, c’est revivre, revivre avec ses traits, son cœur, son génie : la langue n’est que le reflet de l’âme ». Car toute son œuvre découle d’une philosophie de l’histoire. La guerre des Albigeois est une guerre juste, menée par les combattants de la Liberté. Peyrat proclame : « je suis un vieux coq de la Liberté », et il voit dans les guerres anciennes les antécédents de la lutte pour la liberté, qui est toujours actuelle. Lorsque, patriote, après 1870, il cherche les causes de la défaite, il place dans la bouche de Dieu des reproches à son peuple :
« C’est vous qui m’avez dit insolemment adieu
Niez tout, souillez tout blasphémez tout, et Dieu,
Et le Christ, et la Bible, et l’âme…
Et il le blâme en particulier, par allusion à la guerre de Sécession,
Toi, peuple au cœur républicain
d’être allé au sol américain où la grande république s’arrachait du cœur le noir cancer de l’esclavage »
Enfin sept disciples de Peyrat, le 26 avril 1896, fondent à Foix l’Escolo de Mount-Ségur : autour de Prosper Estieu, Président d’honneur, Arthur Caussou, de Lavelanet, Auguste Teulié, de Rabat, Jean Gadrat, Joseph Aybram, de Tarascon, François Rigal, montalbanais fuxéen d’adoption, Paul Dunac, « Pol de Mounègre ».
La revue, qui se veut revue littéraire, précise : « nous nous sommes abreuvés à la source amère et fortifiante de l’histoire si mal connue et tellement falsifiée de la terre d’oc ». Chaque numéro fait référence à l’Aujol, « noble semeur des idées écloses en nos âmes ».
Mais c’est dans l’Almanac Patouès de l’Ariéjo de 1913 que l’on me permettra de déceler la trace, assez fantasque, de l’influence de Peyrat. A. Caussou y publia en effet un texte, intitulé Lampagie, souvenirs du pays de Foix :
« Lampagie, fille d’Eudes, duc d’Aquitaine, fut mariée, toute jeune, à Munuza, un des chefs rebelles des Maures de l’Ebre Munuza, guerrier courageux et hardi, se souvenant des malheurs que les Arabes ou Sarrasins avaient fait subir aux Maures, ses compatriotes, et des misères que s’acharnaient à leur faire les gouverneurs, avait pris la résolution, par un sentiment plus enraciné chez un Chrétien que chez un Mahométan, de les délivrer de la tyrannie qui les écrasait, et de les rétablir dans leur ancienne liberté ». L’anecdote est historique, et pour faire érudit, et légitimer son affabulation, A. Caussou cite en bas de page la Marca Hispanica et dom Vaissette (sans autre précision, et pour cause !). Munuza était en effet un chef maure (ou kabyle) qui commandait en Cerdagne où il s’était rendu autonome. Le duc d’Aquitaine pensait pouvoir faire alliance avec lui, et lui donna sa fille Lampagie, ce qui inspira à N.Peyrat une ode en VII chants : Lampagie, légende ibéro-mauresque. Lampagie était « du sang cantabre et grec l’agreste et fier mélange ». Bien entendu, l’histoire est transposée « jusqu’à Ramos d’Arise, au pied même des monts ».
Dans la réalité, la rébellion de Munuza appelait une riposte. Il fut vaincu en 732 à Llivia, où sur la place une mosaïque commémore l’événement. Et la malheureuse Lampagie fut envoyée dans un harem. Mais cette fin ne convenait ni à Peyrat ni à Caussou. Celui-ci la poste en haut des remparts de Julia Livia, d’où elle suivit la bataille et vit la défaite et la mort de Munuza. La nuit venue, suivie de sa sœur de lait Mirza, elle alla au milieu des morts et des mourants reconnaître celui de son mari, et trouva le cadavre affreusement mutilé. Avec l’aide de Mirza elle traîna le corps décapité hors du champ de bataille et l’ensevelit sous un tertre de pierre. Mais ensuite elle se faufila jusqu’au camp des Arabes, qui dormaient, et s’empara de la tête coupée. Pendant trois jours et trois nuits elles ont marché avec leur fardeau, vers Montségur où étaient retranchés les soldats du duc d’Aquitaine. Le troisième jour, pour éviter la cavalerie d‘Abderraman lancée à leur poursuite elles se cachent dans la grotte de Fontestorbe. Enfin, le quatrième jour, elles arrivèrent à Montségur. Et c’est ici que Caussou rejoint Peyrat : « elle dépose l’urne en un crypte sombre/ Dors, dit-elle, attends moi, car mon âme, ô chère ombre / revient ». Une crypte sombre : ce ne peut être qu’un souterrain sous Montségur ! Elle l’y dépose, et « la tête de Munuza gisant est encore dans la roche sous le donjon ». Et là, « quelques jours plus tard, de chagrin, Lampagie rendit à Dieu le dernier soupir » (et donc a tenu envers la tête sa promesse de retour). Péroraison : « honneur, enfants, à Lampagie! Honneur à l’héroïque fille du pays de Foix ! ».
Cette très libre interprétation montre le disciple imitant le maître, comme lui situant l’histoire dans son propre pays, et surtout la focalisation sur Montségur. A. Caussou a utilisé le procédé cher aux conteurs, ancrant leur récit dans un lieu connu de l’auditoire. Mais Montségur transformé en mythe a surgi spontanément dans son esprit. L’anecdote s’était passée en Cerdagne, mais puisqu’il était question de liberté, elle devait fatalement se terminer sous et dans la citadelle. En 1913 N.Peyrat était mort, pour les félibres la métamorphose était accomplie.
Comme tout le félibrige, les félibres rouges se sont épuisés en disputes autour de la graphie, mistralienne ou non. Ils ont toujours été minoritaires, la guerre de 1914 leur porte un coup fatal. Le symbole de Montségur s’affadit. On y montait en pèlerinage, aujourd’hui on acquitte un droit d’entrée.
N. Peyrat meurt en 1881. Il est inhumé à St Germain-en Laye, et cet exil est sa dernière souffrance :
Mes deux filles échevelées
Ne ramèneront pas, d’ombre et de deuil voilées
Dans la grotte d’Azil mes os mélodieux…
Je dormirai sous la feuillée
De ma forêt brumeuse aux bises effeuillées
Le Christ, ma foi, mon cœur, m’imposent cet exil
Mais l’Arise étonnée et plaintive en son antre
Murmurera : pourquoi mon chantre
Ne repose-t-il pas près des héros d’Azil ?
Il a lui-même défini sa source d’inspiration : c’est le poète de l’exil. Et cet exil est moins l’exil de sa terre natale, que l’exil de son enfance, du grand châtaignier de Larmissa sous lequel dort son père, de Rébaillou et de sa vie agreste et ses chevauchées sur le cheval Morico, des contes de ses tantes et des récits de guerre de ses oncles, la patrie perdue dont il a toute sa vie gardé la nostalgie, et qu’il a voulu rechercher dans l’histoire. En fait, c’est le reproche, incompris de Réville, qu’on peut lui faire : son terroir, les Bordes, baptisé Ramos, est au cœur de tous ses écrits. Si l’histoire huguenote coïncidait avec la mémoire orale de sa famille, il a adopté les Albigeois pour ancêtres. Leur sépulcre oublié ne pouvait surgir que des textes. Et, dans ses outrances, c’est son mérite : il l’a ressuscité, et nous a rendu Montségur.
© Annie Cazenave
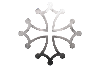
Femmes occitanes
©Annie Cazenave pour Rencontres de Montségur
Ce titre vise à souligner la singularité des Occitanes : elle date d’une haute époque, est célébrée durant celle des troubadours, puis, dès le XIIIème s. niée dans le droit nouveau, venu avec les vainqueurs, elle semble effacée en surface mais survit dans les mœurs et les coutumes, faisant de l’occitane actuelle, l’héritière involontaire de ses aïeules.
Car cette féminité formait l’une des composantes de la société méridionale, et même la caractérisait : survivant en sourdine, tiendrait–elle de l’inconscient collectif ?
Maurice Genevoix, à propos de son expérience de 1914, s’écriait que « la légende se superpose toujours à la guerre ». La Canso n’est que légende, composée par le vainqueur. Et, comme l’écrit Michel Jas, nous n’avons que des « soubassements mémoriels et fragiles, des ancrages locaux ». Mais nous les avons. Certes nous est seule transmise la « vérité judiciaire », à nous d’écarter les barreaux. René Nelli l’a admirablement fait dans La vie quotidienne en Languedoc au XIIème s. et E. Le Roy Ladurie dans Montaillou village occitan. Cette résurgence n’a aucun rapport avec la caricature de Julien Théry ; « grand récit épique érigé en mythe occitan, si facile à populariser, belle image vendeuse d’un occitanisme de pacotille ».
La société méridionale, bouleversée par la Croisade, a résisté en profondeur, dans les mœurs du peuple. Par exemple, la coseigneurie, trait caractéristique de la société languedocienne, a disparu avec l’installation des Croisés, qui ont apporté avec eux les coutumes et le droit des pays d’oil : les Lévis ont durant trois générations suivi la coutume de Paris, y compris pour leur sépulture, les corps des défunts revenant en Île de France dans leur chapelle familiale. Mais les paysans ont continué à pratiquer le partage en famille, si courant qu’on l’appelle la fratrisia : lorsque deux ou trois frères exploitent en commun leur terre. Non seulement ils travaillent, mais ils vivent ensemble, avec femmes et enfants, dans l’oustal, la maison, qui porte leur nom. Et que gouverne la dona, la mère : ainsi de na Belot régentant ses fils, de Mengarde Clergue après la mort de son mari, à Ax de Sibylle Bayle et de na Narbona Gombert, mère de tisserands, l’une et l’autre brûlées.
La maison peut lui appartenir. Selon le droit occitan ancien : à son mariage son père donne à son mari la dot, et à elle son douaire, qui lui est personnel et qu’elle transmet à ses enfants.
Lorsque Sybille Bayle décida d’héberger chez elle les Bons Hommes, elle en expulsa son notaire de mari qui avait repris au rez-de-chaussée l’étude de son beau-père (motif probable de leur mariage). Il est reparti à Tarascon, sa ville natale, ouvrir une étude, et ils ont partagé les enfants, la fille était déjà mariée à la Seo d’Urgel, il est reparti avec Arnaud, qui, portant son prénom, se nommait comme lui Arnaud Sicre, elle a gardé les deux autres garçons, Bernard, et Pons, dès lors appelés Bayle. Pons, devenu Bon chrétien, a été brûlé, comme elle, Bernard a fui en Aragon. Arnaud Sicre, élevé par son père en haine des « hérétiques », devenu espion de l’évêque, a réussi à faire capturer les croyants pour lesquels sa mère l’avait rejeté.
Sibylle Bayle était « cap d’ostal », maîtresse de sa maison, héritière suivant le droit pyrénéen, figurant dans les fors de Béarn de Gaston III en 1180, repris par Gaston Fébus en 1388. Son histoire s’insère entre les deux fors, et si les fors de Béarn ne concernent pas le Sabartès, c’est le cas pour ceux de Gaston Fébus. Tous deux s’inscrivent bien dans l’esprit du droit privé méridional qu’a étudié Paul Ourliac.
Isaure Gratacos dans sa thèse de doctorat : Femmes pyrénéennes, rédigée après une enquête orale de terrain de plus de vingt ans, menée en gascon, « ethnologie du dedans » étayée par des recherches d’archives, a mis en évidence « avec passion et impertinence, une structure anthropologique originale, le statut exceptionnel de la femme pyrénéenne » : l’égalité juridique et économique de l’homme et de la femme, sans prééminence mais avec réciprocité. Cette structure, évidemment ignorée du code napoléonien, persiste dans la mentalité et les coutumes, jusqu’au XXéme s. Et même, récemment, une étudiante à l’université de Pau a mené pour son diplôme une enquête auprès de ses grands-parents : tous deux en racontant leur vie expriment avec clarté la coutume : le mari dit bien qu’il est « venu gendre » , es vengut en gendre dans sa belle-famille : selon la tradition, encore vivante en Andorre, l’héritière épousait un cadet. La transmission du bien primait sur le choix individuel.
Pierre Bourdieu dans Le bal des célibataires, après avoir assisté à un bal en Béarn avec son cousin, qui a analysé pour lui les stratégies matrimoniales villageoises, visant dans les sociétés traditionnelles à transmettre le patrimoine sans l’éparpiller, en tire des conclusions qu’il va vérifier en Kabylie. Or, le fondement de sa théorie repose sur la transmission faite exclusivement entre mâles : il ignore les travaux d’Isaure Gratacos. sur la femme pyrénéenne. Ils restent d’ailleurs tranquillement ignorés des intellectuels parisiens clamant à grands cris le féminisme. Mieux vaut aller en Kabylie ou en pays dogon qu’interroger un autochtone patoisant.
Mais Bourdieu n’est pas montagnard : son village natal, Denguin, traversé par l’autoroute, est situé dans la vallée et ne mène pas la vie pastorale pyrénéenne. Car ses habitants se posent le problème de la transmission du nom, de mâle en mâle. Mais Pons et Bernard en restant chez leur mère ont tout naturellement pris son nom. Ce sont des Bayle : le nom est attaché à la maison. Au point qu’en pays basque la tombe va avec la maison.
C’est précisément au pays basque qu’Isaure Gratacos situe l’origine de ces coutumes si anciennes, qu’elle attribue au « peuple primitif basque », sous l’influence sans doute de Jacques Dendaletche, qui date du néolithique la vie pastorale et en particulier le mode de construction des orris. Or, depuis, les travaux d’hémotypologie du professeur Jacques Ruffié, ont permis d’identifier une race primitive pyrénéenne, répandue le long de la chaîne, porteuse d’un groupe sanguin ailleurs très rare.
Sibylle Bayle, dans la circonstance qui se présentait à elle, s’est servie de la coutume pour sa croyance Paul Ourliac avait bien saisi cette greffe lorsqu’il a constaté que la convenensa, le pacte entre un croyant et un Bon chrétien par lequel celui-ci s’engageait à aller sur sa demande administrer le consolament à un mourant, appliquait la clause connue en droit sous le nom de convenentia. Les croyants se sont tout naturellement approprié leur droit à leur usage.
Le mariage
Essentiel dans la vie d’une femme, le mariage est d’abord un fait social, un contrat entre deux familles du même milieu. Le pivot de l’affaire est la dot. Cette commère de Sibylle Peyre, commentant le mariage de Bernard Clergue avec Raimonde Belot, dont la dot est inférieure à ce qu’il aurait pu prétendre, estime qu’il l’a fait parce que les deux familles sont hérétiques, ce qui est vrai, mais qu’elle n’ait pu imaginer un mariage d’amour montre bien la façon dont ils étaient d’habitude conclus.
La dot importe au point que le remariage de la veuve Raimonde Belot a intrigué le tribunal « ce n’est pas sans raison, elle dont les biens valent environ cinquante livres, qu’elle a épousé un homme aussi pauvre, qui possède à peu près quinze livres et n’a pas de métier » (c'est-à-dire est le valet de ses frères). Elle se défend en citant les marieurs, selon la coutume, ils sont huit dont un prêtre, ce qui semble beaucoup pour un remariage avec son voisin. Mais la curiosité de l’évêque cache une menace : Arnaud Lizier, son premier mari, a été assassiné, et le crime est resté impuni : il avait eu le tort d’être catholique dans le Montaillou cathare, il en savait peut-être trop, il était dangereux, on l’a retrouvé mort, lardé de coups de poignard.
Trois ans plus tard, sa veuve entre dans une maison cathare et suspecte. Elle a commencé par nier avoir eu une liaison antérieure avec son second mari, mais a été forcée de reconnaître qu’elle était croyante du vivant du premier et que sa voisine était son amie. Elle risque d’être soupçonnée de complicité de meurtre et se défend adroitement. Après six mois de prison, elle raconte ce qu’elle sait… sur les autres voisins, les Benet. Sur sa belle-famille, rien ! ils ont beau être anéantis elle leur reste fidèle.
Au pire, elle a épousé l’un des meurtriers, et l’a remercié ainsi de l’avoir libérée.
Identité patronymique
Le prénom d’Esclarmonde a fait fortune. Son succès de nos jours est compréhensible, il sonne bien et, célèbre, a été quatre fois transmis dans la famille de Foix, de tante à nièce, dont la brûlée de Montségur, et la dernière, épouse de l’infant d’Aragon devenue reine de Majorque. Toutefois il s’insère dans la cinquantaine de prénoms féminins insolites.
Déversons, en vrac : Corba, Bélissende, Orbria, Arpaix, Almodis, Marquesia, Fournière, Hélis, Braida, Gauzion, Fabrissa, Séréna,Vésiade, Alazaïs ou Adalaïs, Auceine, Gailharde, Pélégrina, Ava, Faye, Guiraude, Mabilia, Nova, Gausia, Navarre, Barchinona, Saurine, Gausiande, Gaya, Auda, Mersende, Sibylle, Rixende, Alissende, Astruga, Narbona, Fina, Asperte ou Esperte, Montana, Gentilis, Bruna, Helis, Condors, Mathena, Gausia, Ayglantina, Cerdana, Vascalonia, Narbona, Tosa, Rossa, Placentia, Grazida, Lombarda, Albia, Ava, Flors, Honors, Galiana, Stantia, Bosaurs, Gensa, Miracla, Carbona, Dulcia…
On n’a pas relevé les prénoms féminisés : Raimonda, Bernarda, Guillelma, Hugua, Jacoba… car les prénoms masculins sont chrétiens, encore portés pour la plupart : Pierre (Peyre), Bernard, Guilhem, Raimond, Jammes (Jacques) Félipe (Philippe) Bartholomé, Arnaud, Jordan (Georges), Vézian, Amiel, Alzieu, Pons et Prades sont devenus patronymes, Usalger a disparu.
Pour les prénoms féminins, après Esclarmonde, le plus porté, de la fille noble à la servante, les plus courants sont : Alazaïs, Fabrissa, Sibilia (francisé en Sibylle) Auda et Grazida. Mais, par exemple, ceux de Corba, Orbria et Arpaix, brûlées à Montségur, n’ont pas été repris Et les chartes publiées par dom de Vic et Vaissette dans l’Histoire du Languedoc ne mentionnent pas cette étonnante multitude. Les registres d’inquisition, source de notre liste, n’indiquent rien sur eux, sinon qu’ils ne sont pas « cathares » d’origine : des témoins cités ne sont même pas suspects, comme Adalaïs la nourrice d’Auda Fabre, du Merviel, venue justement certifier son orthodoxie. La plupart, et c’est le plus curieux, n’apparaissent qu’une fois. Le souvenir du bourgeois d’Assise qui, rentrant de France, a donné à son fils le prénom de François, aurait porté à attribuer à Barsalona, Lombarda, Navarra, Cerdana, une raison géographique. Mais leurs parents sont enracinés dans leurs villages. Braida de Montserer est la grand-mère de Braida de Mirepoix. Mais Arpaïx del Congost, décédée en 1209, n’a pu être la marraine de la jeune Arpaïx de Mirepoix, brûlée à Montségur.
La courte durée de vie ne permet de généalogie que sur trois générations, mais elle suffit pour constater que le prénom ne se transmet pas de l’une à l’autre, à une exception près : dans la famille Gombert, Astruga la mère a donné son propre prénom à sa fille. Et elles sont les seules prénommées ainsi — mais dans une famille paternelle comportant trois brûlés : la mère aurait-elle voulu enter sa fille sur la sienne ?
À Ax précisément, les liens dans l’entourage des Authié permettent de constater qu’on peut prendre comme parrain et marraine des amis : le choix du prénom est alors indiscernable.
D’autre part, la fécondité rend inventif. Mais une telle surprenante abondance !
Anne Brenon avait bien remarqué cette singularité, et dans Femmes cathares leur avait donné chair et vie, par exemple dans l’anecdote touchante où, lors du départ de sa mère le nourrisson dans son berceau gazouille, sa mère revient l’embrasser, et ne peut s’en séparer, retourne plusieurs fois sur ses pas pour le serrer à nouveau : anecdote pieuse racontée aux femmes pour imager le détachement nécessaire à la vraie croyante.
Certes les églises sont généralement placées sous le patronage d’un saint, non d’une sainte. Mais à Tarascon on vénère sainte Quitterie, et à Pamiers sainte Natalène. Aucune ne le porte, ni même un nom de sainte. Marie même, le plus courant, le plus banal ailleurs, serait absent de la liste s’il ne se trouvait à Génat une Maria Englesia (de l’église) et une Marie nonne à la chapelle de Sabart, précisément dédiée à Notre-Dame : aurait-elle été « vouée » enfant ? L’état d’esprit en Sabartès exclut cette pratique pieuse.
Au contraire, on peut s’étonner que toutes ces femmes à leur baptême aient reçus de si nombreux prénoms, tous insolites, dans l’indifférence du clergé.
Le sexe
Choix de la partenaire
Raimonda Arcen, interrogée, explique le choix fait par les hommes de leur partenaire. On ne lui demandait que son attitude envers le sexe, pour tester son orthodoxie, elle détaille : la règle : mère et sœur, interdit, parentes par le sang, mal vu mais possible, normal avec des femmes « étrangères », c'est-à-dire sans lien de parenté. Ce sont les lois non écrites qui régissent les coutumes : les hommes évitent « le mélange des humeurs » remarqué par Françoise Héritier-Augé . Ainsi, un témoin se scandalise que Rixende Bayard ait, après avoir fait annuler son mariage avec Arnaud de Château-Verdun, épousé Pierre de Miglos : ils sont cousins, et tous les deux ont « connu » Rixende.
Cet accroc choque en particulier dans les amours ancillaires, nombreuses. Les gens de Caussou blâment leur seigneur, qui a pris pour servante la nièce après la tante, et les a toutes deux mises dans son lit. Le bayle d’Ax a couché avec deux sœurs, et à Tarascon Guilhem Bayard s’est vanté de l’avoir doublement fait, avec deux fois deux sœurs, Gauda et Blanca, et Ermessinde et Arrnalda, toutes quatre du proche village de Banat, mais aux reproches il a répondu qu’il ne se souciait pas de ces faytilhas (broutilles )
Une femme en vaut une autre
L’évêque se trouve donc devant le paradoxe de réprimer deux attitudes contradictoires, l’hérésie, qui condamne tout lien charnel, et la liberté des mœurs, dans l’ignorance du mariage chrétien, consacré par un sacrement. Il envoie aux Allemans le malheureux Pierre Vidal, de Foix, qui persistait à ne rien trouver de répréhensible à coucher avec une femme, si elle est consentante et s’ils se sont mis d’accord sur le prix.
Le fuxéen se conduit… en fuxéen. Ce n’est qu’un début du XIVème s. que l’évêque de Pamiers, Dominique Grima interdit le cortège des jeunes qui défilaient dans l’église St Volusien en brandissant des bannières « où sont peintes les parties honteuses de l’homme et de la femme » en s’inclinant, déguisés en femmes, devant le maître de cérémonie, appelé prieur . Ce devait être un jeu de carnaval, celui de la cour cornuelle a duré jusqu’à la moitié du XIXème s. : elle jugeait les « cornus », c'est-à-dire les cocus (et non leurs femmes), considérant que s’ils l’étaient, c’était de leur faute.
En fait, Jacques Fournier liait les deux attitudes avec raison : puisque « le mariage ne vaut rien », des lascars en avaient tiré une conclusion à leur avantage, Mais les femmes regimbaient, trois d’entre elles assurent que la muflerie masculine les a dégoûtées de leur croyance. Mengarde Savignac répétait la leçon donnée par Guillelma Déjean : « une femme en vaut une autre, sauf sa mère, sa sœur et sa cousine germaine ». Guillelma, sœur de Prades Tavernier, la tenait de lui, en ajoutant l’interdit de l’inceste à la condamnation de la chair.
Mais elle n’a pas eu l’idée de l’adapter en donnant une version féminine. Les Authié professaient en effet : « le mariage ne vaut rien, quand l’Église en célèbre un, elle agit en entremetteuse. Le vrai mariage est spirituel, c’est celui de l’âme ; le mariage charnel n’est qu’une association ». – constat que ces notaires avaient dû faire dans l’exercice de leur métier.
Mais leurs croyants l’entendaient autrement. Fabrissa den Riba, lorsque, sur le seuil de sa porte elle fait des reproches à Pierre Clergue, qui prend son village pour un harem, s’attire cette riposte, rentre chez elle, furieuse, préférant ne pas répondre, car, s’écrie-t-elle, son oule (sa marmite, sa tête) bouillait. Cette fois on obtient le point de vue féminin !
Le tribunal ne s’y trompe pas, et prend la liberté sexuelle comme un critère permettant de présumer l’hérésie. Les témoins montrent leur bonne volonté en s’étendant sur des histoires scabreuses qu’ils estiment sans danger, sans donner au mot « péché » le sens désiré : « une femme en vaut une autre ». L’un d’eux l’exprime avec franchise : c’est la nature, l’animal ne commet pas de péché ».
Mais quand Bernard Belot s’attaque à la propriété d’un autre, en l’occurrence agresse la femme de Guilhem Authié, le mari s’adresse à la justice, le fait emprisonner, et se fait remettre une amende de vingt livres. On est loin du crime d’honneur.
Lorsque les aveux de Béatrix de Planissoles, révélant une liaison vieille de vingt ans, révèlent en même temps l’adhésion au catharisme de Pierre Clergue, Jacques Fournier fait venir la dernière en date, la jeune Grazida Lizier. Elle dépose d’abord avec cran : elle avait quatorze ans quand, au temps de la moisson, où sa mère était occupée, Pierre Clergue vint lui demander de la connaître charnellement, et il la « déflora » dans le pailler. Et il revint la voir fréquemment, au vu et au su de sa mère, de jour. Six mois plus tard, en janvier, il la maria à Pierre Lizier , et durant les quatre ans que vécut son mari il continua de la voir, « la priant de se garder de tout autre qu’eux deux » (sic). Elle n’y voit aucun mal « puisque cela me plaisait et au recteur aussi ». Selon la morale du Sabartès il a bien agi envers elle, bâtarde, en la mariant il l’a sauvée de la pauvreté. Et elle n’a aucune conscience d’avoir pu déplaire à Dieu, elle répète : « puisque cela me plaisait ». L’évêque l’envoie réfléchir aux Allemans — où, dans la chambre des dames, elle retrouve, entre autres, Béatrix de Planissoles. On lui apprend alors comment se conduire devant le tribunal, et à l’audience suivante la luronne joue la victime, qui a cédé par peur du curé et de ses frères. Elle renie son amant en prison : elle a appris comment se défendre, et se conforme à la morale sexuelle apprise.
Elle s’en tire avec un an et demi au Mur, commué en port des croix.
L’amasia
Les notaires prenaient sur le vif, à l’audience, un plumitif qu’ils traduisaient ensuite en latin, ce qui leur posait parfois des problèmes : ils saisissaient les paroles prononcées et les interprétaient, c’est ainsi que le Bon chrétien devient systématiquement un hérétique.
Leur attitude envers le sexe était plus prude que celle des témoins. Parfois ils traduisaient exactement : ils couchaient, il fit la chose charnelle, ou, pudique : ils s’unirent, s’en écartent : il la connut charnellement, intervenant carrément : ledit péché perpétré. Et il est douteux que Grazida ait dit qu’elle a été « déflorée » — en revanche la précision : dans le pailler donne une dimension temporelle à une pratique toujours en usage ! Les « relations déshonnêtes » seraient aujourd’hui appelées liaison stable. Car ils savent aussi apprécier les sentiments et la délicatesse du cœur : ils fréquentaient (mot populaire, toujours usuel) et pour : aimer ils emploient deux verbes : diligebat, adamabat.
De même qu’ils ont gardé le mot, intraduisible, de cabessal, ils reconnaissent l’existence de l’amasia : ce joli mot désigne la compagne : mariées à quatorze ans, les jeunes femmes s’émancipaient et découvraient l’amour : la situation est si fréquente qu’elle a suscité ce joli nom d’amasia. C’est un attachement durable, l’amasia, mariée ou veuve, est toujours de la même condition que son amant, n’est pas sa concubine et ne vit pas avec lui. Elle devient amasia de son propre gré, et, dans la connivence générale, vit un bonheur en marge.
Simon Barre accordait à sa femme ce qu’il s’autorisait lui — même : elle avait une liaison avec Guilhem Carot : c’était un « grand croyant », qui un jour l’emmena voir des hérétiques. Elle l’a dit à son mari, qui l’a raconté à Raimond Vaissière, qui l’a répété à l’inquisiteur. Le fait est prescrit, Simon Barre est mort, et sa femme, remariée, non avec Guilhem Carot, mais avec Arnaud Gouzy, vit à Pamiers.
À Luzenac l’amasia de Pierre de Luzenac, na Palharèse, suivante de sa mère, vit dans sa propre maison, où son amant invite les Authié. Elle se retire pour les laisser dîner ensemble. Na Palharèse fait du colportage de fromage, qui lui permet d’être la messagère des Bons chrétiens.
À Ax Moneta Rauzy, veuve d’un notaire, est l’amasia de Pierre Authié, auquel elle a donné un fils, Bon Guilhem, qui a suivi son père et son oncle en Lombardie, et au retour les a précédés pour préparer leur venue.
À Génat, Mersende a été l’amasia d’Arnaud Marty, qui était croyant, avant qu’il ne la quitte pour se faire consoler Bon chrétien. Il a été brûlé. Mersende est devenue la servante et concubine du fils du seigneur de Génat, Jacques, marié, dont elle a deux enfants, avant d’épouser un homme qui veut bien se charger de sa progéniture — dans l’espoir que leur père se souviendra de les entretenir.
Amasia, Vuissane aurait bien voulu devenir mieux, épouse. Partie toute jeune servante près de Pamiers, elle en revient lestée d’une fille. Engagée comme servante dans la maison Belot, elle tombe amoureuse du fils, Bernard, qui lui fait deux enfants. Elle s’échine à travailler toute la journée chez eux, dans l’espoir qu’il l’épousera. Mais leur cousin Arnaud Vidal la détrompe : « même si tu étais la plus riche du comté il ne t’épouserait pas, parce que tu n’es pas de la foi, et qu’il ne pourrait pas avoir confiance en toi ». Alors elle se fait expliquer cette foi, et devient croyante par amour. En vain. Elle n’est pas invitée aux réunions du soir, et Bernard Belot se fiance avec une jeune fille de la croyance, et qui a une dot. Renvoyée pour lui céder la place elle part, enceinte, le cœur gros. Et épouse un brave homme, Bernard Testanière, Mais il n’est pas souple, et refuse d’être suborné et d’entrer dans les intrigues de Montaillou. Donc ils partent, et l’évêque, qui l’a citée pour l’entendre témoigner sur cette famille condamnée, la retrouve à Saurat. Elle dépose sur sa jeunesse. Mais ceci est une autre histoire.
Combien sont-elles, ces femmes qui ont réussi à être heureuses en assumant leur part de liberté ? Leur silhouette traverse ces récits, toujours une simple ombre, mêlée de loin à « l’hérésie ». Alazaïs Fabre, la seule à témoigner, la seule dont on connaît l’histoire, est émouvante. Elle est malheureuse chez elle, son mari est brouillé avec son père, qui n’a pas payé la dot, et son frère, petit berger de quinze ans, est mourant. Elle a trouvé la tendresse qui lui manquait auprès d’Arnaud Vidal, le cordonnier. Il possède le caractère attribué traditionnellement à ceux de son métier, c’est un beau parleur. Et c’est le mari dont Raimonde jeune mariée a été jalouse. Mais elle ne l’est plus, le curé Clergue est passé par là.
Alazaïs a pour parler de la « familiarité déshonnête « qui les unit des mots que le notaire ne peut censurer : entre eux ils parlent, ils conversent, et si de leurs entretiens le greffier n’a retenu que ce qui l’intéresse, le lien avec l’hérésie, elle insiste avec nostalgie sur son amour pour lui, que « multum diligebat », elle lui confiait ses craintes, sa tristesse, son hésitation sur la conduite à tenir envers son frère mourant — qui finalement sera consolé, motif de l’interrogatoire. Son amant est mort, et le drame les a tous emporté. Mais dans le clair-obscur d’un atelier de cordonnier elle a goûté aux délices de l’amour partagé.
La dernière enfin, l’intrépide : Raimonde, la sœur d’Arnaud Marty, l’amasia de Guilhem Bélibaste. Leur aventure a inspiré un roman à Henri Gougaud. On la connaît grâce à Pierre Maury, la victime, on voudrait la vivre du côté de l’amoureuse.
Quand Bélibaste, encore croyant, était en Sabartès, Raimonde a été son amasia : sa sœur a confié à Pierre Maury qu’elle les avait surpris au lit ensemble. Lorsqu’il s’est évadé du Mur, Raimonde a quitté son mari Arnaud Piquier, en emmenant sa fille, et l’a rejoint, d’abord en Catalogne, près de Tarragone : un homme du Sabartès qui « faisait du bois » a remarqué dans l’auberge quelqu’un qui mangeait solitaire à une table, et une femme et une fille l’accompagnaient Le soupçonnant d’être un hérétique il a proposé à l’aubergiste d’aller tous deux le dénoncer, pour toucher la prime. Mais l’autre a refusé, parce qu’il fallait durant le transport rester enchaîné au prisonnier — ce qu’a supporté Arnaud Sicre.
C’est là, près des filatures, qu’il a dû apprendre le métier qu’il exerçait, fabricant de peignes, plus profitable à ses yeux que celui de berger. Car il était obsédé par le besoin d’argent, qui a causé sa perte, pour pouvoir payer son passage vers la Sicile. Il en rêvait, pour moi, dit-il, et « cette femme qui est avec moi ». Donc il veut partir en l’emmenant.
La petite communauté de croyants exilés du Sabartès trouvait astucieux son camouflage en homme marié chargé de famille — un peu éloigné d’eux toutefois, pratique pour écarter le soupçon.
Catastrophe : un enfant s’annonce. Horrifié à l’idée de sa honte future il combine le mariage de Raimonde avec ce brave type de Pierre Maury, qu’il a déjà grugé impunément. Ce mariage dura trois jours, ou plutôt trois nuits, et il le tirait d’affaire, sans doute à ses yeux pour de bon. Mais Raimonde ne supporte pas cette situation humiliante, et ne veut pas le perdre, elle lui fait une scène violente, il s’incline et défait ce qu’il avait fait. Et qui suffit pour que Pierre Maury accepte sa paternité à venir. Mais à la révélation de Blanche il comprend qu’il a été joué, et se tait.
Raimonde éprouve un amour éperdu : elle a tout quitté, pays, mari et condition stable, pour aller le retrouver et partager sa vie de fugitif. Les sentiments de Guilhem sont plus équivoques. Question insoluble : l’a-t-il fait prévenir de son évasion, ou l’a-t-elle appris et décidé seule de sa fuite ? qu’elle se soit ou non imposée elle l’a rejoint et ils ne se sont plus quittés, sauf pour le bref épisode du mariage contraint, mais vite annulé. Mais annulé à cause de sa colère : avait-il cru trouver la solution pour se débarrasser d’elle et de son encombrant fardeau ? Et, honteux, il l’a repris.
Puis il a suivi l’espion, qui l’a fait tomber dans le piège, par appât de l’argent qu’il lui a fait miroiter, mais avec l’intention de retourner riche et partir avec elle en Sicile.
Car il vit un amour interdit. Il respecte l’interdit alimentaire, non l’interdit sexuel. Tourmenté, partagé entre la passion et la foi, il a perdu la grâce du consolament, et n’a aucun Bon chrétien pour le consoler à nouveau.
Et d’ailleurs, s’il l’avait été, il aurait dû se séparer de Raimonde. Le désirait-il ? Il a cédé et annulé le mariage trompeur : être privé de Raimonde a dû paraître insupportable. Il a dû se débattre dans des tourments inouïs. Il est le dernier, mais le seul qui n’ait pas quitté définitivement sa femme. Sur le chemin de la prison il a voulu se suicider et proposé à Sicre, auquel il était enchaîné, de monter en haut de la tour et de se jeter dans le vide. Il avait encore : des illusions !
Pierre Maury a raconté son aventure à l’évêque de Pamiers — non à l’inquisiteur d’Aragon. Il a donné sa version d’ami trahi. Sans lui leur couple singulier aurait été englouti dans l’oubli où basculent les anonymes. Raimonde a en effet disparu dans la foule aragonaise
Et comme elle, ces rebelles se sont effacés dans les brumes du passé, dormant entre les pages d’un manuscrit oublié. Jusqu’à leur résurgence.
©Annie Cazenave – droits réservés
Sources (récap)
*Pierre Bourdieu Le bal des célibataires Seuil 2015
*Anne Brenon Femmes cathares Éditions Perrin coll. « Tempus », 2005
*Annie Cazenave, « Mariage, sexe et choix féminin en Sabartés » in : Der Hahnenrei im Mittelalter, Le cocu au Moyen-Âge Greifswald,,1994.
*Jean Duvernoy, Le registre d'inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325), Toulouse, 1965 Paris] : éd. Tchou et Bibliothèque des introuvables, impr. 2004
*Fouquart de Cambray, Duval Antoine, Jean d'Arras Les évangiles des quenouilles en langue d'oil et en picard Recueil de contes médiévaux enchâssés publiés à Bruges chez Colart Mansion - 1480.
*Maurice Genevoix Sous Verdun Coll. « Mémoires et récits de guerre », Flammarion, 1916)
*Henri Gougaud, Bélibaste (Points 101)
*Isaure Gratacos, Fées et gestes. Femmes pyrénéennes : un statut social exceptionnel en Europe. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 44ᵉ année, N. 2, 1989..
www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1989_num_44_2_283599_t1_0424_0000_003
*Françoise Héritier -Augé Les deux sœurs et leur mère, Paris, 1994.
*Emmanuel Leroy Ladurie Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 Coll Bibliothèque des Histoires Gallimard
*Gadrat Poèmes de carnaval de Triboulet, éd.Gadrat, Foix, 1829.
*M.Prou et A.de Bouard, Manuel de paléographie latine et française Paris,
4ème éd., 1924
La plupart des noms et références sont pris dans Le registre d’inquisition de Jacques Fournier-. A. ACazenave, « Mariage, sexe et choix féminin en Sabartés » in : Der Hahnenrei im Mittelalter, Le cocu au Moyen-Âge Greifswald,,1994.
Le mot appartient au dialecte local, il n’est ni dans Alibert, ni dans Mistral, mais se trouve dans le dictionnaire occitan de l’ariégeois d’Adelin Moulis. « Honteux » doit traduire le mot vergougno, vergogne, qui en oc a un sens plus large, englobant le scrupule.
L’anathème de Dominique Grima, conservé dans un manuscrit de la B.M. de Toulouse, est édité dans le Manuel de paléographie latine et française de M.Prou et A.de Bouard, Paris, 4ème éd., 1924. Poèmes de carnaval de Triboulet, éd.Gadrat, Foix, 1829. **

